Entretien avec Jean-Christophe Attias autour de son premier roman, Nos Conversations Célestes ( Alma, janvier 2020).
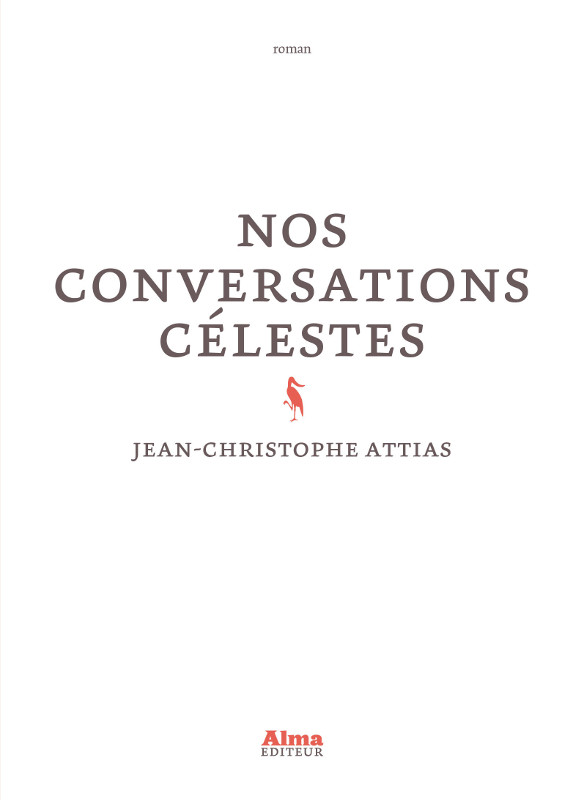
Que se passe-t-il lorsqu’un professeur des Universités, titulaire d’une chaire de pensée juive médiévale à l’EPHE, écrit un premier roman ? Un livre-monde, un livre fait d’autres livres et qui vaut tous les autres. Un livre qui commence comme une évocation du petit milieu universitaire d’un Institut quelconque, un peu comme dans Un tout Petit Monde de David Lodge, avec la même jubilation à décrire ses travers, ses manies, ses drôleries et ses constipations, et dont l’intrigue est celle d’un roman policier : un collègue, Ben Halfman (un mi-homme, une moitié d’homme) a disparu, et le recteur charge Jacques et sa secrétaire Mauricette de le retrouver. L’enquête les mène dans les bureaux parisiens d’un rabbin tunisien qui a hérité des affaires de drogue de son père en Colombie, dans des villes de France, dans un Israël ultra-technologique où on fait des vérifications de circoncisions à l’aéroport et où l’Auteur est peut-être un agent du Shabak. On y entre comme dans une enquête de Simenon, d’autant que le disparu est, c’est le cas de le dire, un personnage ! Chercheur loufoque et brillant, magnifique et vivant, Ben Halfman a passé son audition en transformant une canne en serpent (on se demande comme qui) et en racontant ses histoires, la tradition vivante face à la science qui parfois archive et enterre, sclérose au lieu de vivifier. Sauf que, petit à petit, le récit se fissure, laisse entrer le doute, puis la bizarrerie. Les cheveux de Mauricette qui sont bruns, n’étaient-ils pas blonds ? Ou roux ? Et pourquoi Jacques a-t-il des souvenirs qui ne sont pas les siens, pourquoi est-il traversé par des expériences, des vies, autres que les siennes ? Tout en gardant un pied dans Simenon, on met l’autre sur le sol tremblant et fragile d’un Kafka dopé à la mystique juive. Le récit, qui offre une vraie jouissance de l’écriture, de la formule parfaite, quoique se teintant d’une étrangeté un peu angoissante, reste férocement drôle et diablement touchant.
La quête se fait intérieure et le ton plus inspiré : « Il n’y a pas d’Auteur, Mauricette. Et son histoire n’est rien d’autre que celle du désir. » « Nul ne priait là, le Mur était en pierre et n’était l’oreille de personne. » « Nous approchions de ces terres arides où Rien se révèle aux va-nu-pieds. Chacun s’y croit prophète quand il est modeste. Messie quand il l’est un peu moins. Dieu quand il ne l’est pas du tout. Vous leur flanquez une gifle, et ils vous déclenchent une guerre mondiale pour cent générations. Celui-là était peut-être juif. Ou chrétien. Ou musulman. Ça n’avait d’ailleurs aucune importance. C’était une question de nuance. Le sang devait couler, il coulerait. Celui du martyr avec celui de l’infidèle. On trancherait des têtes, on couperait des mains, on monterait sur la croix, on irait au massacre en chantant, on répandrait sur la terre les viscères mêlés des purs et des impurs. »
On comprend finalement avoir été mené en bateau, initié plus exactement, par l’Auteur qui n’existe pas, et qui nous a offert avec ce livre une plongée plus honnête encore qu’une autobiographie dans les récits, contradictions, et mémoires qui le composent.
Un roman puissant, dérangeant, fascinant. À lire.
Jean-Christophe Attias en parle avec nous dans cet entretien

Noémie Issan-Benchimol : Vous êtes très fort quand même, vous savez que j’ai googlisé le nom du mystique juif Meshoullam ben Nissim Triki et de son traité d’angélologie qui ouvre et clôt en un sens votre livre, me disant : tiens, celui-là je ne le connais pas ? Puis ça m’a frappé, Triki, comme en slang hébraïque pour dire la pierre d’achoppement, comme aussi le trickster des histoires…
Jean-Christophe Attias : Vous n’êtes pas la seule à qui c’est arrivé. J’imaginais avoir écrit une histoire invraisemblable, désordonnée, extravagante… Et voilà que des lecteurs m’avouent être allés voir sur le Net si tel ou tel détail, lieu ou personnage existait bel et bien dans les faits. D’abord, ça m’a surpris. Ensuite, ça m’a ravi. Toute cohérence, même folle, produit un effet de réalité auquel il semble difficile de se soustraire. C’est la magie du roman, je suppose. Tout y est faux, donc tout y est vrai. Ou plutôt non : ce que l’on croit possiblement vrai… est faux, et vice versa.
Comme vous l’avez sûrement remarqué, il y a deux Triki dans le roman. Le mystique dont vous parlez, prétendument auteur, au début du XIXe siècle, d’un traité d’angélologie juive jamais imprimé. Et puis un autre, personnage à part entière de l’intrigue, pas moins mystique, mais disons plus pratique : un rabbin gay qui fait des miracles. On peut imaginer que l’un est le descendant de l’autre, mais ça n’est dit nulle part. Ni l’un ni l’autre n’existent, bien sûr. Quoique…
À la fin des années 1980, je vis en Israël, tout ne va pas vraiment comme je veux dans ma vie, et voilà qu’on me recommande un certain rabbin Triki, grand producteur d’amulettes. Je ne suis plus le Juif religieux que j’ai été dans ma jeunesse, et d’ailleurs je n’ai jamais cru à ces bêtises. Et pourtant je prends rendez-vous, j’y vais, je le retrouve chez lui, au second étage d’un immeuble ensablé au fin fond d’une banlieue écrasée de soleil et un peu triste, c’est un jeudi, ou une veille de shabbat, je croise madame, une nombreuse progéniture, il y a une bonne odeur de nourriture, l’entretien avec le saint homme dure peu de temps, il est petit, barbu, même pas vieux, et pas du tout impressionnant, je ne sais plus aujourd’hui ce que j’ai pu lui raconter alors, sans doute pas que je vis dans le péché, ni que j’entends bien continuer, peu importe d’ailleurs, je ressors de chez lui avec mon grigri juif en poche, et j’en suis tout heureux, non, confus, non, honteux.
Voilà le rabbin Triki que j’ai rencontré. Il s’appelait vraiment comme ça. On pourrait sûrement vérifier… Ce nom ne m’en évoque bien sûr pas moins, comme vous le dites, le truc, l’artifice, l’entourloupe. La filouterie mystique. Avec le recul, je ne vois pas pourquoi ça n’aurait pas marché… D’ailleurs, vous avez vu ? Dans le roman, ça marche…
“Le judaïsme est dans mon texte comme dans ma vie : plus présent là où il est invisible, que là où on le voit.”
N. I-B. : J’ai été frappée par l’usage que vous avez fait de l’onomastique en général dans votre livre, parfois hilarante (avec le professeur Shmok, pâle chercheur qui meurt vraiment comme un shmok) parfois profonde, comme avec le Kfar Aloum, le village disparu, ce non-lieu où les damnés de la terre vivent ensemble, où un jeune Arabe est un prophète et le kabbaliste un homosexuel qui l’aime de ses deux cœurs… Certains jeux de mots ou allusions resteront sans doute obscurs pour certains de vos lecteurs, pourquoi alors ? Le plaisir de laisser des indices ?
J-C. A. : Sûrement. Tous les personnages de mon roman sont doubles. Son épilogue l’est aussi. Pourquoi sa langue ne le serait-elle pas un peu ? Il y a les cas que vous citez. Il y en a quelques autres. Tout aussi visibles. D’autres encore qui le sont moins. Et même certains que je suis probablement le seul à voir. Le livre est écrit en français. Oui. Mais il est aussi parfois écrit en hébreu. Simplement, ça n’est pas toujours perceptible. C’est un peu comme le levain dans la pâte, on ne le voit pas, on ne le sent pas, et pourtant la pâte lève. Ou mieux encore : c’est comme le grain qu’on sème au hasard. Il germera, ou pas. On verra bien. Le judaïsme est dans mon texte comme dans ma vie : plus présent là où il est invisible, que là où on le voit. Certains lecteurs ne s’en rendront pas compte ? Aucune importance. Rien ne m’interdit de croire qu’ils en seront affectés tout de même, secrètement, à leur insu. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il serait préférable que le livre ne soit jamais traduit en hébreu. La transparence est l’ennemie du bonheur, y compris littéraire…
“Citer, c’est voler, et c’est détourner.”
N. I-B. : La citation imaginaire, pour quelqu’un qui a passé sa vie à citer le plus exactement et fidèlement ses sources, n’est-ce pas une façon de pointer la supériorité du roman sur la forme d’écriture de la recherche scientifique ? J’ai pensé à ce mot d’Imre Toth dans Palimpseste : « Fragments de textes préalablement donnés-cela s’appelle citation. L’assemblage permet donc l’assemblage d’un texte constitué uniquement de citations. Il permet aussi, c’est évident, de citer des textes inexistants : ce sont alors des textes écrits exprès et pour l’unique raison d’être cités. » Ça fait quoi de pouvoir, par la puissance de l’imagination, devenir un mystique sépharade du début du XIXe siècle ? Et pourquoi la mystique, et non la philosophie ou la théologie, a ici le dernier mot ?
J-C. A. : Toute citation, si « authentique » soit-elle, est le produit d’un acte de démembrement. Et ce n’est pas une belle note en bas de page qui suffira à vous sauver de l’enfer. Tout fragment arraché à son contexte devient autre chose que ce qu’il est. Il ne prouve rien. C’est vous qui le forcez à prouver quelque chose. Citer, c’est voler, et c’est détourner. Et à certains égards, toute citation, par définition, renvoie à un texte qui, dès lors que vous l’avez démembré, n’existe plus. Toute citation déréalise le texte d’où elle est tirée.
Pourquoi l’inverse ne serait-il pas possible, toute citation imaginaire faisant advenir à l’être un texte qui n’existe pas ? D’ailleurs, peut-on vraiment parler de « citation imaginaire » ? On peut facilement prouver qu’une citation provient bel et bien d’un texte existant. Mais qui peut vraiment démontrer le caractère « imaginaire » d’une citation « imaginaire » ? On peut juste dire qu’on n’a pas encore trouvé le texte d’où elle est tirée. D’ailleurs, nous exprimons-nous autrement que par citations ? Ce que je vous dis là maintenant, quelqu’un l’a certainement déjà dit avant moi…
Voilà qui me permet d’ailleurs de répondre à l’autre partie de votre question. Ma famille paternelle, comme d’autres familles juives nord-africaines, a conservé, je crois, le souvenir obscur d’un mystérieux ancêtre, si versé dans la Kabbale qu’il en aurait perdu la raison au point d’avoir laissé là femme et enfants et de s’en être allé, seul, un jour ou une nuit, au fond de quelque désert, braver les lions et découvrir la Vérité, pour n’en jamais revenir. Je ne vois pas pourquoi, si dilué que soit en moi cet héritage, il ne me serait pas resté de lui, cent ou deux cents ans plus tard quelque chose – et même quelques mots, quelques phrases « imaginaires ». Ce roman aura été mon désert à moi… De fait, l’ancien rabbin Triki de mon livre n’est-il pas devenu, par l’effet d’une évidente forgerie de l’Auteur, le théoricien inattendu d’une origine angélique – et mystique – du genre romanesque lui-même ?
“Il n’y a pas de mezouza à la porte de mon appartement. Il y en a une, en revanche, à la porte de mon bureau, là où j’écris.”
N. I-B. : La sénatrice aux cheveux rouges, qui n’est pas un personnage principal de votre roman, tout du moins pas explicitement, y apparait exactement comme Charlie de la collection enfantine « Où est Charlie ? », elle ponctue votre livre et elle le fait avec un signe iconographique, ses cheveux rouges, tout comme vous y êtes iconographiquement par vos lunettes violettes. Elles représentent quoi pour vous, ces couleurs ?
J-C. A. : La sénatrice n’est bien sûr pas seulement là où on la voit clairement. Elle est partout et nulle part. Quand elle apparaît vraiment, elle n’est peut-être qu’un leurre. Et ce qui compte alors, c’est la couleur de ses cheveux. Rouge. Rien, dans cette histoire, n’est stable. Rien, surtout, de ce qu’on voit. Sauf, peut-être, les couleurs. Le rouge, la vie et le sang. Le jaune, la mort. Le noir, le crime. Le rose et le bleu ensemble, l’amour. Le violet, le désir. Il y a les cheveux rouges de la sénatrice. Les yeux jaunes d’Eti. Le noir du manche d’un couteau. Le rose et le bleu de son collier. Les lunettes mauves du « jeune homme ». Pourtant, méfiez-vous, même les couleurs et leurs sens se dérobent, et s’inversent. Parce que les couleurs ne sont accessibles qu’aux yeux, et que nos yeux nous trompent. Tous mes personnages, et d’abord le Narrateur, sont en quête d’une incarnation, ce qui est bien naturel s’ils ne veulent pas rester juste des personnages, à savoir des ombres. Or un seul sens nous garantit l’incarnation : le toucher… Lorsque deux personnages se touchent, voilà soudain qu’ils existent. Et ce qui est vrai de personnages est vrai de chacun de nous. S’il est une chose que notre expérience du récent confinement et des « gestes barrières » nous a apprise, c’est bien cela. Le toucher nous manque. Le toucher, plus qu’aucun autre sens, nous fait ce que nous sommes : des êtres sensibles, sociaux, humains. Sans le toucher, nous commençons à perdre la certitude de notre propre existence…

N. I-B. : Je voudrais qu’on parle un peu d’un des personnages qui m’a le plus touchée dans votre roman : la mezouza, l’immense mezouza saignante comme une relique, au design kitsch, cette mezouza que dans une de ses rêveries Jacques se fait arracher de ses entrailles par un chirurgien-boucher exactement comme dans les Toledot, Yeshu Jésus se fait arracher le nom de Dieu qu’il s’était glissé sous la peau. Cette mezouza, elle est accrochée sur la porte de votre maison ?
J-C. A. : Dans le dédale qu’est le récit, certains objets resurgissent régulièrement. Et lorsque le lecteur croit s’égarer, ils lui servent de repères. Ils le rassurent. Ils sont une preuve de la continuité de l’intrigue, sinon le signe de sa cohérence. Un collier. Un couteau. Des lunettes. Un bracelet électronique. Une table de Formica. Un carrelage en damier. Cette mezouza aussi, bien sûr. Mais elle est plus qu’un indice, plus qu’un objet. Elle est, comme vous le dites, un personnage à part entière. Elle est un texte dans le texte, un texte dans le corps. Elle est la clé de l’énigme. Elle révèle in extremis le secret des êtres. Elle est vivante. Elle saigne, comme tous les vivants. Et elle doit être réparée, comme tous les vivants. Son texte, bien que sacré, est fautif. Mais c’est cette faute qui dit la vérité. Je ne peux pas en dévoiler plus. Il faudra lire pour savoir…
Il n’y a pas de mezouza à la porte de mon appartement. Il y en a une, en revanche, à la porte de mon bureau, là où j’écris. Toute simple, discrète. Je n’en ai jamais fait vérifier le texte. Elle est pourtant bien vieille. Elle doit avoir pas loin de cent ans. Elle n’a jamais saigné, mais je ne serais pas étonné qu’elle saigne un jour. C’est une relique, en effet. Elle est le seul vestige qu’en 1962 ma grand-mère paternelle ait rapporté en France de sa maison d’Algérie. Sa vérité à elle est là : c’est la vérité de l’exil.
« Ben ? Toucher Dieu? Vous plaisantez. Il a juste voulu vous séduire. S’il touche jamais Dieu un jour, ce sera pour le gifler. Ben est un blasphémateur. Il se moque bien de Dieu et méprise les croyants. Voilà trente ans qu’il étudie le judaïsme comme une œuvre d’imagination. Certes parfois magnifique, mais le plus souvent puérile. Il n’admire que les médiévaux. “Eux, au moins, dit-il souvent, pensaient quelque chose. Ils pouvaient le penser mal, ou faussement, mais c’était leur vie qu’ils jouaient sur ce coup-là. Les rabbins d’aujourd’hui n’ont rien dans la tête, ils ont pour la plupart cédé aux sirènes d’un nationalisme tribal, et sont tout juste bons à marier et à enterrer les gens encore assez stupides pour solliciter leurs services. Tout le monde se pâme devant François, mais ce pape-là comme les autres exhale une pénible odeur de vieux plâtre. Quant à l’islam, c’est une fournaise, il brûle tout, les barbares et les doux. Il y avait de la poésie dans la religion, il n’en reste presque plus rien. C’est cela qu’il faudrait faire entendre aux laïcs. Mais les laïcs eux-mêmes ont perdu le goût de la poésie. »
N. I-B. : Vous faites dire à Jacques ces propos sur Ben : « Ben aimait se compromettre. Il me disait parfois : “Un intellectuel public, c’est un peu comme une femme publique. Ça ne choisit pas toujours ses clients.” Son idée était simple. Il faut sauver les principes, peu importe qui en est bénéficiaire. Ceux que l’on doit défendre ne sont pas forcément sympathiques. Ni moraux. Ni beaux. Ni propres. Ils ont le droit d’avoir mauvaise haleine. Et il faut aller les voir pour savoir qui l’on défend. Leur parler, les écouter, les toucher. S’asseoir avec eux, manger et boire avec eux. » Est-ce également votre crédo à vous, en tant qu’intellectuel public aux yeux décillés ? Vous ne croyiez donc pas à l’angélisation des victimes ?
J-C. A. : J’ai peut-être été naïf, autrefois, et je n’ai pas toujours vu clair. J’ai peut-être imaginé qu’un passé ou un présent de souffrances immunisait contre la tentation du mal. Je sais aujourd’hui que tel n’est pas le cas. C’est vrai de toutes les victimes. C’est vrai de tous les descendants de victimes. C’est vrai des Juifs comme des autres. Il faut reconnaître les victimes pour ce qu’elles sont au moment où elles le sont. Ni des anges, ni des saints. Juste des hommes et des femmes en butte à l’injustice, payant d’une souffrance démesurée, imméritée, notre injustice.
Lorsqu’un homme meurt pour rien sous les coups des forces de l’ordre, s’il perd un œil ou une main, s’il porte toute sa vie les séquelles de la violence qu’il a subie, je ne me demande pas s’il avait un casier, s’il était connu des services de police, s’il était sympathique ou pas, s’il pensait comme moi ou pas, s’il était pauvre ou riche, si nous étions du même monde ou pas, ça n’est pas le sujet. J’exige pour lui la vérité et la justice. Rien d’autre. Parce qu’il est un homme comme moi. Je ne choisis pas mes « clients », en effet. Je dois en revanche les approcher et tenter de les connaître, autant qu’il m’est possible. Et remonter la chaîne des causes.
Juste un exemple encore. Visiter un camp de migrants est une épreuve. Je l’ai fait plusieurs fois au côté de ma sénatrice aux cheveux rouges. On croise alors bien des visages humains. Il y a sûrement là des héros. Il n’y a pas là de saints, ni d’anges. Il y a surtout là des hommes et des femmes dans la détresse et qui espèrent. Et il n’y a pas d’autre question à se poser à ce moment-là que celle-ci : comment soulager cette détresse, comment secourir cette espérance, comment briser le cercle de l’injustice, de l’abandon et de l’indifférence ? Quand presse l’urgence, le reste est secondaire. Pour tendre la main à son prochain, on n’a besoin, on n’a le droit ni d’exiger de lui qu’il soit un pur, ni de s’imaginer qu’il l’est.
“Notre problème à nous, Juifs, est moins le nationalisme que le messianisme en politique.”
N. I-B. : Jean-Christophe, vous êtes mon directeur de thèse, je connais de vous le scientifique, et parfois, en tombant sur telle ou telle phrase, telle tournure, j’ai eu la sensation que vous formuliez, peut-être pour la première fois aussi crûment et clairement non pas une position de chercheur, mais une position existentielle d’homme, de juif, de penseur du judaïsme et des religions : «Ben reconnaissait au judaïsme, jusqu’à l’avènement du sionisme, une unique vertu : celle d’être une religion de la défaite assumée et du renoncement à la gloire. Une religion du suicide symbolique, mystérieuse combinaison de capitulation et de résistance, paradoxale condition de la survie. ». Cette vision, qui a sa poésie mais que je ne partage pas forcément, elle attribue une certaine superbe, un panache, voire une valeur à une condition de survie précaire, apolitique. Vous n’aimez pas la politique en son sens westphalien, non ? Un territoire, une frontière, une installation, des victoires, une armée, tout ça, ça vous fait un peu horreur on dirait, surtout pour des Juifs…
J-C. A. : C’est vrai, je n’aime pas trop les territoires, les frontières, et je me méfie des victoires… Elles se paient souvent très cher. Vous imaginez bien quelles conquêtes, et quelles annexions (ou projets d’annexion) je peux avoir en tête. Cela étant dit, le poison nationaliste, la fièvre irrédentiste me révulsent où qu’ils se manifestent, où qu’ils produisent leurs ravages. Chez les Juifs comme chez les autres, ni plus, ni moins.
Mais prenez garde. Je ne suis pas Ben, je ne suis aucun de mes personnages, ou alors je suis tous mes personnages, et donc un être contradictoire. Si Ben révèle quelque chose de moi, il ne révèle pas tout de moi, évidemment. Je déplore souvent que le judaïsme se soit dégradé en politique. Cela ne fait pas de moi un « antisioniste ». Il y a cent vingt ans, j’aurais d’ailleurs peut-être été un sioniste ardent, parce que le sionisme fut d’abord subversion et acte de résistance (y compris contre l’establishment juif). Que les Juifs aient leur État, pourquoi pas ? Je n’y vois pas d’objection. Mais si l’on pouvait réparer tout ce qui peut l’être et tenir le judaïsme aussi éloigné que possible de cela, ce ne serait pas plus mal.
Notre problème à nous, Juifs, est moins le nationalisme que le messianisme en politique. Le Messie ne négocie pas, hélas, il impose sa loi… Israël n’est pas la fin de l’histoire juive. Ni son terme, ni son sens ultime. Israël n’est ni la tête, ni le cœur d’un monde juif qui l’excède et qui, lui, n’a pas de frontières. Résister, aujourd’hui, c’est se battre, si c’est encore possible, pour un judaïsme diasporique incluant Israël mais ne s’y soumettant pas…
“Toute méthode est bonne qui contribue à rendre intelligible l’objet auquel elle s’applique.”
N. I-B. : Vous n’être pas, en un sens classique, religieux, ou peut-être l’êtes vous trop. Ce livre ne serait-il pas la trace religieuse que vous voulez laisser ? Ça ne pouvait pas être un texte de halakha (loi juive), évidemment, et encore moins un livre de religion (prescrivant, pontifiant). Alors le roman, comme forme moderne et seule acceptable de théologie, non systématique, non euclidienne ?
J-C. A. : Peut-être. Tout cela me rappelle surtout une conversation que j’ai eue, il y a plus de vingt-cinq ans, avec le regretté Charles Mopsik (1956-2003). J’étais encore accroché, alors, à une conception étroite et rigide de la « scientificité » en études juives. J’étais l’apôtre convaincu et un peu ridicule d’une prise de distance maximale avec l’objet de mes soins. J’étais à cheval sur tout : sur la méthode, sur les moyens, et sur les fins. Il fallait résister à l’objet, ne rien se laisser dicter par lui, oublier qu’on était juif, et surtout ne faire aucune concession aux attentes des Juifs vivants. Charles Mopsik m’avait simplement objecté au détour d’une phrase quelque chose comme ça : toute méthode est bonne qui contribue à rendre intelligible l’objet auquel elle s’applique. Je suis assez d’accord avec ça, aujourd’hui. Écrivant avant-hier une biographie « imaginaire » de Moïse, racontant hier ma propre histoire dans un récit autobiographique, et accouchant aujourd’hui d’un roman, j’essaie, autant que par mes travaux antérieurs, en donnant enfin toute sa place à l’émotion, au rire et au doute, de continuer à rendre le judaïsme « intelligible » à tous. Ce faisant, je sais, je brouille quelques frontières. Entre la science et la théologie, entre l’histoire et la fiction, entre mon objet et moi. Je suis juste peut-être plus sincère et j’assume mes paradoxes. Je ne fais plus semblant de ne pas être là. Je suis là… J’ai d’ailleurs toujours été là. Dieu aussi est peut-être là. Enfin, de ça, je doute un peu quand même…
N. I-B. : Pour décrire certaines religions ésotériques anciennes, on parle de culte à mystères, accepteriez-vous qu’on parle de votre livre comme d’un roman à mystères ?
J-C. A. : D’accord, un roman à mystères. Si ça vous va, ça me va aussi. Un roman à mystères. Un pied de nez à la mort. Et une sacrée bonne blague aussi quand même…
Entretien réalisé par Noémie Issan-Benchimol
Jean-Christophe Attias est Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (Université PSL), chaire de pensée juive médiévale (VIe-XVIIe siècles).
Derniers ouvrages publiés : Nos conversations célestes (Alma, 2020) ; A Woman Called Moses, Londres, New York, Verso, 2020 ; également auteur de Un juif de mauvaise foi (Lattès, 2017).
Goncourt de la biographie 2015 pour Moïse fragile (Alma, 2015, rééd. poche, CNRS Éd., coll. « Biblis », 2016).
Commander Nos conversations célestes (Alma, 2020) sur le site leslibraires.fr
Le site de Jean-Christophe Attias
© photos : DR
Article publié le 5 octobre 2020. Tous droits de reproduction et de représentation réservés © 2020 Jewpop