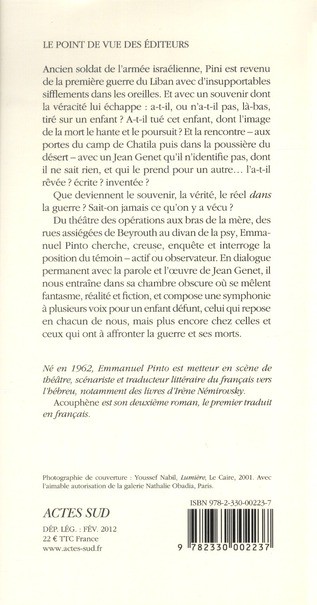« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?
(Andromaque de Racine, scène finale)
Je me rappelle mon entrée en 6ème avec ses journées plus longues, ses nouvelles matières, la multiplication des professeurs, je me rappelle les années 1990. Je me rappelle les cours de français, la découverte d’une liste de lecture longue comme le bras à avaler avant la fin de la 3ème ; des mots à dévorer avant la fin du Collège pour mes pauvres collègues et moi-même.
Je me rappelle de l’obligation de choisir un roman dans la liste, d’en faire un exposé. Je me rappelle de mon choix, fait sur un titre évocateur pour un gamin de 10 ans. Je me rappelle qu’un ami avait choisi Les Misérables de Victor Hugo, cela devait sans doute lui dire quelque chose, il en a eu pour plus de mille pages et ses deux années de 6ème.
Je me rappelle mes insomnies (déjà !), je me rappelle d’un auteur au nom de femme. J’avais lu Voyage au bout de la Nuit de Céline, j’usais pourtant mes fonds de culotte sur les bancs d’un collège ultra-orthodoxe.
Parfois, au nom des mots, fallait-il pénétrer en territoire ennemi. Pour voir la forme de l’adversaire, pour entendre ses cris, pour le comprendre. Pour le vaincre, et pour savoir enfin qui on tue et pour qui on meurt.
Avec une puissance proprement stupéfiante, Emmanuel Pinto pose son verbe sonore qui hurle dans nos têtes l’horreur de la guerre du Liban en 1982, son lot de non-dits, de controverses. S’inscrivant dans la lignée du grand film d’animation Valse avec Bachir, son roman Acouphène, relate le destin de Pini, soldat israélien intervenant au Liban durant la période de Sabra et Chatila.
Avant toute chose, il s’agit bien d’un roman. D’une part, parce qu’Emmanuel Pinto fait œuvre littéraire et non historique, il ne s’attache pas à évoquer avec minutie le déroulement des évènements, mais plutôt à plonger son lecteur dans la conscience de plus en plus brumeuse de son personnage. D’autre part, parce que dans un exercice de style aussi audacieux que réussi, son texte fait de Jean Genet un autre de ses héros.
Un mot sur Jean Genet. Jean-Paul Sartre, qui était pourtant l’un de ses grands admirateurs, convenait de l’antisémitisme assumé de celui-ci, tout en s’inclinant devant son génie littéraire. Ce « voyou, le sale gosse de Saint-Germain » comme on pouvait le surnommer, a aussi largement montré son parti pris envers les palestiniens dans de nombreux écrits, tels que Le captif amoureux et Quatre heures à Chatila.
Mais Jean Genet, c’est surtout un plume inoubliable, un rapport assumé au mal et à la perversion (lisez Notre-Dame-des-Fleurs ou Journal du voleur si vous avez du temps et suffisamment d’estomac), et donc une ambiguïté constante, pas exempte de variations, dans son jugement du monde et de l’humanité.
Emmanuel Pinto confronte donc le regard de plus en plus voilé d’un soldat, qui voit son meilleur ami tomber au combat, puis qui sauve son unité en tuant un enfant armé d’un lance-roquettes, avec le regard toujours imprévisible de l’écrivain erratique. En cercles concentriques de plus en plus serrés, sa prose, d’une poésie rare et troublante, puisqu’elle s’inscrit dans celle de Jean Genet (une véritable prouesse !), navigue entre ces deux points de vue, comme un champ/contre-champ au cinéma, jusqu’à finir par les embrasser dans une même focale au cours de scènes d’anthologie, les plus belles que j’ai lues depuis longtemps.
On doit donc souligner la qualité de la traduction de Laurent Cohen, qui est d’une musicalité telle que l’on croirait le roman écrit en français. Et l’on peut ainsi saluer la politique éditoriale de la maison Actes Sud, qui, outre publier le grand américain Don DeLillo (vous vous pâmerez devant Cosmopolis, film sélectionné pour l’ édition 2012 du Festival de Cannes, adapté par David Cronenberg avec Robert Pattinson dans le rôle principal) ou Mathias Enard (l’un des romanciers français de grande ambition), a développé une brillante collection de textes israéliens, Lettres Hébraïques.
C’est d’ailleurs de l’hébreu dont il est question dans la seconde partie du roman. Celle-ci évoque la même période, mais vécue par Mona, la mère de Pini. Cette partie, que d’aucuns pourraient trouver de prime abord en décalage, ne montre pas l’instinct maternel éploré, mais l’acquisition de la langue par Mona à mesure qu’elle écrit à son fils. Elle découvre le pouvoir des mots, de la maîtrise de la fiction sur le réel.
Car en filigrane, Acouphène est une interrogation sur la capacité qu’ont les mots, puis les images, à transformer le réel en mythologie. Si la première partie, descriptive, met en scène Jean Genet, un écrivain capricieux, raillant les uns et les autres mais écrivant finalement bien peu dans ces moments, la seconde partie montre l’œuvre-même d’un écrivain. En effet, la prose n’est plus événementielle, mais vêt les sensations et les émotions violentes de la mère, qui prennent le dessus sur la guerre à travers ses lettres.
Ces écrits, bouleversants, finissent d’achever le propos ainsi que les blessures infligées et subies. De maux en maux. Mot à mot.
Jonathan Aleksandrowicz