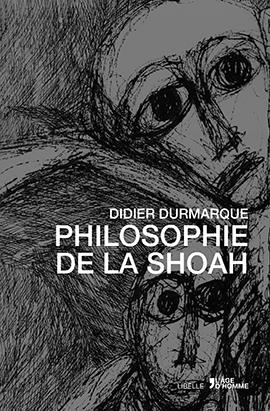Il y a quelques temps le philosophe Didier Durmarque publiait un ouvrage dont le titre pouvait surprendre, Philosophie de la Shoah. Le lecteur aurait pu être tenté de le traduire par Philosophie de l’anéantissement ou, s’inspirant de Raul Hilberg, par Philosophie de la destruction des Juifs d’Europe voire par Philosophie de l’extermination des Juifs d’Europe. Intrigué, il pourrait même pu proposer de le reformuler par La philosophie face à la Shoah.
Le mot Shoah n’est pas de trop
L’utilisation du mot Shoah pose encore problème, comme j’ai pu le constater lors de son utilisation dans de précédentes publications. Plus précis que « génocide », moins déplacé qu’« holocauste », plus distancié que l’expression nazie « solution finale » (die Endlösung), moins confidentiel que « judéocide », le mot hébreu « Shoah » est apparu à partir du milieu des années 80 comme plus adapté pour désigner ce processus unique d’extermination systématique des traces physiques et mémorielles des Juifs d’Europe.
Si ce mot ne fait toujours pas l’unanimité, et continue à être questionné, aucun autre terme n’a réussi véritablement à s’imposer. Le mot Shoah est toutefois devenu d’un usage si courant qu’il est immédiatement compréhensible pour chacun de nous. Ce mot, utilisé dans la Bible hébraïque, désigne une catastrophe, une désolation, un désastre, etc… Provoqué par une intervention divine (Psaumes 35.8 ; Proverbes 1.27 ; Isaïe 10.3, 47.11 ; Sophonie 1.15 ), un état (semi) naturel (Job 30.3, 30.14, 38.27) ou une action humaine (Psaumes 35.17 ; 63.10 ; Proverbes 3.25 ; Ezéchiel 38.9;). Il désigne donc une série de phénomènes qui peuvent être soit d’origine divine, soit (semi) naturelle, soit humaine.
D’où mon désaccord avec la position qu’avait pris Henri Meschonnic, dans une tribune publiée dans Le Monde en 2005 intitulée « Pour en finir avec le mot « Shoah », qui voyait dans le terme Shoah, utilisé « pour désigner l’extermination des juifs », « un mot qui désigne un phénomène de la nature pour dire une barbarie toute humaine ». Cette focalisation (« phénomène de la nature ») est à l’évidence abusivement réductrice et imprécise. Henri Meschonnic interprète trop rapidement en ne prenant en compte, comme seule possible, que l’origine naturelle (Job), passant sous silence l’intervention divine, contestable, mais surtout la dernière, celle d’actions humaines. Si l’on peut comprendre qu’Henri Meschonnic ne puisse plus discuter ni rectifier cette erreur manifeste, il est décédé en 2009, on reste tout de même songeur quant à la position dogmatique, encore à ce jour, de quelques perroquets sectaires qui tout en ayant pris connaissance de cette réduction de sens, continuent à ânonner en pilotage automatique comme une vérité intangible cette simplification au point de nier délibérément et ostensiblement les autres sens du mot, faisant œuvre de dissonance cognitive à défaut de rigueur intellectuelle.
A contrario je rejoins Henri Meschonnic lorsqu’il annonce, dans cette même tribune, « que des mots prennent des sens nouveaux, perdent des sens anciens ». C’est typiquement le cas du mot Shoah qui ne constitue pas « une pollution de l’esprit », un « mot empoisonné », qu’il faudrait laisser « aux poubelles de l’histoire », selon le procès lexical engagé par lui, car, ajoute-il, Shoah est un mot hébreu qui « n’était pas la langue de ceux que l’on a massacré. L’hébreu leur était une langue liturgique », d’où son souhait d’abandonner son usage. Dans cette logique il aurait fallu évacuer également tout mot latin et/ou grec (comme génocide), français, anglo-saxon, et n’utiliser que des mot yiddish comme hurbn (hourban, hurban). Mais celui-ci pose aussi problème, car il est principalement associé à la destruction du Temple de Jérusalem, et ce serait oublier par la même occasion les Juifs massacrés qui ne parlaient pas cette langue mais le français, l’allemand, etc… Quant à l’utilisation de mots tirés de l’hébreu biblique, ils se sont parfaitement intégrés dans notre vocabulaire courant, et ce, sans que cela ne pose problème (alléluia, arabe, chérubin, messie, pharaon, saphir, etc…).
En fait, le mot Shoah, dans ce contexte historique particulier, s’est non seulement sécularisé, il est sorti d’une vision théologique à quelques exceptions près, mais en plus il est largement compris comme indissociablement lié à une intervention humaine, celle des nazis et leurs collaborateurs, et non à une action divine ou naturelle. Il apparaît donc tout à fait légitime dans son usage.
Notons également que le mot Shoah, employé pour désigner le processus d’extermination du judaïsme européen par les nazis, est apparu indépendamment et bien des décennies avant le film éponyme de Claude Lanzmann (1985) qui a augmenté sa visibilité et sa popularité. Ainsi, la Journée de la Shoah (Yom HaShoah) date du 5 mai 1959. La date de cette première commémoration a été choisie dans une résolution adoptée par le Parlement d’Israël, la Knesset, le 12 Avril 1951. Parmi la somme des textes usant du mot Shoah avant les années 80, on peut citer au hasard des sources comme : Isaac Toubin, « How to Teach the Shoah », Conservative Judaism, 18, 1964 ; Zalman Ury, « The Shoah and the Jewish School », Jewish Education, 34, 1964; Henri Margolis, Book Reviews, (« With the publication of The Jewish Catastrophe in Europe, a basic book for teaching the Shoah in secondary school classes is now available. Imaginatively designed, this rather comprehensive work tells the story of the Shoah as it happened »), Journal of Jewish Education, Volume 39, Issue 2, 1969 ; Murray J. Kohn, « Holocaust Motives in Hebrew Poetry », (« I have attempted to review and classify the area of Hebrew poetry which has dealt with the theme of the shoah »), Jewish Quarterly, Volume 20, Issue 4, 1973 ; Israel Gutman, « Hashoah verishouma betoldot am Israel», Newsletter [of the] World Union of Jewish Studies, 23, 1984, etc.
Loin d’être un mot « communautaire », « ethnique » ou « religieux », ce mot appartient indubitablement à l’ensemble de l’humanité, à l’histoire universelle. Ce mot désigne un phénomène singulier, dans un espace particulier à un moment donné de l’Histoire. Il n’enlève rien aux autres atrocités commises avant, pendant et après sa réalisation.
Problématisation
Le philosophe Didier Durmarque propose dans cet essai de penser la Shoah non en termes d’événement historique (ne niant rien de cette réalité factuelle), chose que nombre d’historiens ont su décrire et largement analyser – même si certains ont considéré que cet événement était impensable, irreprésentable, énigmatique, incompréhensible, difficilement intelligible, que notre langue manquait de mots pour l’exprimer, qu’il devrait exister un langage propre, un langage d’avant et d’après la Shoah et qu’en l’état actuel cette catastrophe était innommable – mais comme un problème qui impose, dans une métaphysique moderne, de repenser l’être de l’homme et plus précisément à « penser une anthropologie, une philosophie de l’existence, une métaphysique et une esthétique de la Shoah » en réinterrogeant « le socle grec et le socle hébraïque » à partir de cette catastrophe.
Le choc, le traumatisme de la Shoah, imposerait cette problématisation raisonnante d’intégrer et de penser par-delà ce qui est considéré comme impensable pour les uns et indicible pour les autres. Cette démarche proactive de dépassement englobant, se rapprocherait de l’Aufhebung hégélien, en se situant par ailleurs du point de vue de l’universel et « non dans la particularité des chaînes de causalité » trop singulièrement historique. D’où cette volonté de dépassement simultané de la raison historique sans pour autant viser une quelconque transcendance car ce problème est parfaitement immanent. La démarche de Paul Ricoeur pourrait s’inscrire dans cette optique lorsqu’il écrit que « plus nous expliquons historiquement, plus nous sommes indignés ; plus nous sommes frappés par l’horreur, plus nous cherchons à comprendre ».
De l’administration et de la technique
Une attention particulière est portée par l’auteur à la mise en place administrative, bureaucratique et technique, qui a rendu possible, comme moyen, la politique homicide méthodique de près de six millions de Juifs.
Dans une Europe qui a reçu en héritage les Lumières de la raison, de l’Aufklärung à la Haskalah, ce monde moderne n’a peut-être pas assez perçu les détournements possibles de cette raison comme les capacités potentielles des anti-Lumières. Cet effet pervers pouvant prendre la voie du retournement contre elle-même tel qu’on le retrouve dans la dialectique de la raison chez Adorno. Didier Durmarque parle à de multiples reprises d’une « opposition entre le rationnel et le raisonnable », du « divorce entre la raison comme rationalité pure et la raison comme raisonnable », d’une « rationalité [qui] détruit le raisonnable », du « renversement entre une raison calculatoire comme moyen et une raison raisonnable comme fin », d’une « raison instrumentale et calculatoire qui renvoie à l’essence de la technique » dont l’existence et l’humanité de l’homme en feraient les frais. La réification de l’homme « soumis à la loi des choses » (de la technique) l’a fait devenir lui-même une chose. Le nazisme a transmuté, via une bio-politique homicide (teintée de « darwinisme social », d’hygiénisme, d’eugénisme, de raciologie et d’expérimentations médicales) des hommes en untermenschen puis en nicht-menschlichen, une catégorie d’objets déshumanisés, dépersonnalisés, pathologiques, nuisibles, dévitalisés, insignifiants, superflus, des choses à éliminer physiquement et à effacer mémoriellement de la surface de la terre. Le « commando 1005 » (Sonderaktion 1005 ou Enterdungsaktion) est emblématique de cette démarche de dissimulation et d’effacement de traces (corps, os, etc.). La Shoah a été un moment tragique du néant : « – Warum , – Hier ist kein warum » ! Comment communiquer l’inimaginable après cela, et qui trouver en face pour écouter les témoignages ? Les muets parlent aux sourds.
L’idéologie nazie fut le carburant, l’essence politique d’une révolution du nihilisme, qui a su utiliser et adapter un ensemble de personnels, nationaux et de collaborateurs étrangers, d’hommes fonctionnels selon le mot d’Imre Kertesz, et de structures (administration, bureaucratie, industrie, etc.) associés à des moyens (humains et techniques) pour mettre en place un système annihilant. L’être vivant comme le cadavre étaient intégrés dans ce processus d’extermination. Georges Bensoussan notait que « l’idéologie dit le Vrai, qui légitime l’Autorité, laquelle génère l’obéissance ». Dès 1933, les règlements, les décrets, les lois ont su légitimer et normaliser une situation qui a rendu possible la progression des mesures anti-juives : le fichage, les exclusions, la séparation, les expropriations, les arrestations, les internements, le marquage, les déportations, les sélections (quand elles existent) et l’assassinat de millions d’hommes, de femmes et d’enfants. Alliance de criminels de terrain et de bureau dans un système fragmenté, parcellisant les tâches qui ont participé à cette extermination de masse. Les responsabilités individuelles furent diluées et noyées dans cet amas instrumental global : « ce n’est pas moi qui réponds de mes actes, mais mon supérieur, voire le système tout entier ». Comment ne pas ressentir un profond malaise quand nous percevons que nous appartenons à la même famille humaine que les bourreaux ? Ce qui a amené Didier Durmarque à considérer que « le problème métaphysique de la souffrance [est] le premier problème d’une philosophie de l’existence après la Shoah» impliquant de poser et de verbaliser une philosophie de l’existence à partir de ce déchaînement macabre.
Évoquant l’Office central SS pour l’économie et l’administration, SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt (WVHA), Zygmunt Bauman remarque que « l’activité ne différait pas de façon formelle (…) de toutes les autres activités organisées, conçues, contrôlées et supervisées par les sections administratives et économiques « ordinaires » ». Au point que le processus devait être efficace, rentable et économe. On ne saurait trop recommander la lecture de l’ouvrage de Franz Neuman, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme (1933-1945), en particulier la deuxième partie intitulée « L’économie monopoliste totalitaire », même si depuis son écriture on a pu relever quelques limites à cette analyse. Les biens de ceux qui allaient à la mort (vêtements, bijoux, lunettes, cheveux, dents… jusqu’aux os et aux cendres à la sortie des crématoires) étaient recyclés dans le système économique nazi ! Cette logique gestionnaire de « traitement », de « traitement spécial » de « cargaison », fit dire à David Rousset que « les détenus sont des excréments. Mais on peut faire de l’argent avec de la merde ». Pour les nazis, la fin consistait à exterminer spécifiquement une population particulière jusqu’à son dernier représentant. En cela elle avait bien, dans le cadre d’une vision du monde, un but politique, ce qui me différencie sur ce point de l’analyse de Jean-Claude Milner dans Le Juif de savoir. Etty Hillesum écrit dans son journal le 3 juillet 1942 : « Ce qui est en jeu, c’est notre perte et notre extermination, aucune illusion à se faire là-dessus. « On » veut notre extermination totale, il faut accepter cette vérité ». Les Einsatzgruppen et les chambres à gaz, mais aussi la « chasse aux Juifs » (Judenjagd), la mort par la faim et les épidémies, l’épuisement aux travaux forcés, les déportations où nombre furent ceux qui moururent avant l’arrivée en camps de concentration et/ou d’extermination, les « marches de la mort », etc. agirent dans un même but tragique, vers une même fin éradicatrice souhaitée : un monde sans Juifs. La Shoah, l’extermination systématique et méthodique des Juifs européens, ce crime d’État ou plus précisément ce « massacre administratif », a été un moment historique et un moyen qui a pris fin avant que cette extermination totale n’atteigne sa finalité morbide.
Contrairement à la bombe atomique qui « se présentait comme un moyen au service d’une fin » (tuer un ennemi, gagner et terminer une guerre) ou aux goulags russes qui « visaient expressément la domination politique et l’absence de contestation », la Shoah est un moyen perfectionné – « déterminé par l’organisation moderne de la société » – qui en serait sa propre fin, ou pour le dire autrement l’essence de la technique, réduite ici à la chambre à gaz, n’est plus un moyen mais sa propre fin. Ce modèle nazi servira à porter la critique sur les sociétés occidentales modernes dans leur utilisation administrative et technique de moyens (marchés économiques, exploitation, optimisation, rentabilité, restructuration, délocalisation, etc.).
Métaphysique moderne
Est-ce que « la Shoah se livre davantage en tant que problème qu’en tant que fait » ? Sûrement, et pas seulement parce qu’« il y a davantage à penser qu’à comprendre », parce que le fait brut et sa compréhension restent relativement figés dans l’événement historique alors que la pensée est dynamique et mouvante, mais parce qu’en plus la pensée peut se déplacer en de multiples directions d’intelligibilité.
Hannah Arendt témoigne : « Notre propre problème ne résidait pas dans ce que faisaient nos ennemis, mais bien dans ce que faisaient nos amis. C’était comme si un vide s’était créé autour de nous. Je quittai l’Allemagne sous l’empire de cette idée, naturellement quelque peu exagérée : plus jamais ! Jamais plus aucune histoire intellectuelle ne me touchera : je ne veux plus avoir affaire à cette société… Je pensai que la faute en était à ce métier d’intellectuel. D’un côté Hitler, de l’autre des théories bien intéressantes ! Vraiment fantastiques, intéressantes et complexes ! Des théories très au-dessus du quotidien ? C’est cela que j’ai trouvé grotesque. Aujourd’hui, je dirais que ces intellectuels étaient tombés dans le piège de leur propre construction ».
Qu’un philosophe comme Martin Heidegger, dont l’influence reste marquante, ait pu concevoir une réflexion sur les effets pervers de la technique tout en faisant l’impasse sur la nature, l’utilisation et les dérives de celle-ci sous le IIIème Reich, qu’il a connu de l’intérieur, laisse pour le moins assez songeur. S’il « s’est consacré à introduire les fondements du nazisme dans la philosophie et son enseignement », cet ancien membre du NSDAP, à l’antisémitisme avéré, n’a-t-il pas participé par son silence complice à banaliser le nazisme et son idéologie en faisant l’impasse sur son adhésion au parti nazi de 1933 à 1944 ainsi que sur sa contribution philosophique pour le moins sélective dans ses dénonciations de la modernité ? S’il évoque une identique essence (nature) entre l’industrie alimentaire technique et « la fabrication de cadavre dans les chambres à gaz et les camps d’extermination », il oublie, comme le souligne Didier Durmarque, une « différence de degré pour l’utilisation technique qui rend possible l’extermination, puis préciser qu’elle touche, au premier chef, les Juifs, ce que Heidegger tait ». L’antisémitisme du NSDAP était indéniable dès sa fondation en 1919. Gilles Martinez rappelle qu’«il est alors impossible d’adhérer au nazisme ou de voter pour ses candidats sans savoir que les nazis sont profondément et clairement antisémites ». Heidegger n’est assurément pas la meilleure référence intellectuelle à prendre en compte pour porter une critique pertinente sur la modernité technicienne de cette période et donc de la Shoah.
Un autre questionnement est apparu. Fallait-il sauver l’idée de Dieu après la Shoah ? D’autant qu’à l’autre bout, certains pensaient que la Shoah avait été une épreuve divine, une sorte de « catastrophe châtiment » ou de « sacrifice nécessaire à l’histoire du peuple juif ». D’où le mésusage de l’appellation « Holocauste », sacrifice par le feu offert à un Dieu (Lévitique 1. Rituel des sacrifices, Les holocaustes). Face à cette nouvelle insulte, je serai tenté de répondre comme Moses Sonnenschein : « Ici, il n’y a pas de Dieu et s’il y en a un maudit soit-il, maudit soit-il, maudit soit-il ». Et si Dieu était là comme spectateur, alors il doit engager sa responsabilité et attendre une juste sentence, « mais qui pourrait la prononcer ? ».
Homo sum ; humani nihil a me alienum puto (« Je suis un homme ; je considère que rien de ce qui est humain ne m’est étranger »). Certes, mais les hommes et la pensée ne sont pas sortis indemnes de « cette plongée dans l’abjection humaine », trop humaine. Soazig Aaron a formulé son désespoir dans ce verdict radical : « Alors plus de philosophie. Jamais. Comme Dieu est parti en fumée, la philosophie est partie en fumée, toutes les parties de la philosophie, la morale, l’esthétique, etc. tout, tout s’est effondré là-bas, rien n’a tenu, et c’est tant pis. (…) il n’y a plus rien ». Didier Durmarque pensait-il à ce terrible jugement en écrivant sa Philosophie de la Shoah ? Clairvoyante, Soazig Aaron poursuivait : « Pas d’illusion. Je sais qu’il y en aura d’autres, qu’en ce moment, dans des chambres, il s’élabore d’autres philosophies de professeurs, d’autres systèmes, d’autres explications sur les décombres de ce qui vient de se passer, qu’on va encore et encore jacasser à propos de l’Etre et du Non-Etre, avec toutes les majuscules possibles ». Alors qu’un personnage du roman explique que la philosophie n’y est pour rien, que c’est ce qu’on en fait ou n’en fait pas qui importe, la réponse tranchée termina la sentence : « Alors c’est obscène. Si aucun système de pensée n’a suffisamment de force pour s’opposer à douze ans de folie, si aucune philosophie ne baigne assez dans une société au point de l’empêcher de sombrer dans l’obscène, alors elle est elle-même obscène. Ou alors, qu’on prévienne que toutes les savantes élucubrations sont là pour seulement emmerder les étudiants et collectionner les citations ». Martin Heidegger venait de mourir une seconde fois !
Selon Emil Fackenheim, « pour ne pas donner à Hitler la victoire à titre posthume, il est interdit au juif de désespérer de l’homme et de son monde et de s’évader dans le cynisme ou dans le détachement ». Ainsi, pour les mêmes raisons, il nous sera interdit de désespérer de la philosophie, de sa démarche de penser la Shoah comme problème, comme l’a voulu Didier Durmarque dont j’ai discuté ici quelques points qui me paraissaient essentiels.
Valéry Rasplus
Ce texte, ici adapté et augmenté pour la première partie, fut publié la première fois sous le titre ‘Le Philosophe et la Shoah’ sur le blog « Le voyageur social » de Valéry Rasplus, hébergé par L’Obs, publié avec l’aimable autorisation de l’auteur. Le texte original contient un certain nombre de notes absentes de cette dernière version. Le lecteur pourra s’y reporter.
Commander Philosophie de la Shoah de Didier Dumarque (Éditions L’âge D’homme) sur le site de la Fnac (12 €)
© visuel : DR
Article publié le 4 avril 2016. Tous droits de reproduction et de représentation réservés © 2016 Jewpop