Des titres de livres tels que Bar-Cochebas, L’Ombre de la Croix, La Rose de Sâron, Un Royaume de Dieu, Quand Israël est roi, L’An prochain à Jérusalem !, Petite histoire des Juifs… ne vous disent absolument rien ? Pas plus que les noms de leurs auteurs, Jérôme et Jean Tharaud ? Tous deux membres de l’Académie française et lauréats du prix Goncourt, cette fratrie littéraire tombée dans l’oubli fut pourtant le duo star des éditions Plon dans les années 20 et 30. Avec une pléthore d’ouvrage traitant pour beaucoup des mondes juif et arabe, dont les scores de vente feraient pâlir d’envie Eric Zemmour. Une littérature ouvertement antisémite et à la gloire de la colonisation, reflet d’une époque.

Photo de Jean Tharaud (à gauche) et Jérôme Tharaud (à droite) au Maroc (non datée)
« Nous n’avons jamais écrit une ligne l’un sans l’autre »

Jérôme et Jean Tharaud, qui passeront leur vie ensemble jusqu’à habiter sous le même toit durant plusieurs décennies, et cosigneront une cinquantaine de livres et de très nombreux articles comme journalistes, de la Revue des Deux Mondes au Figaro, «offrent une illustration sans équivalent d’une singulière symbiose : la fusion entre deux esprits, deux styles en un seul.» comme le souligne la quatrième de couverture de la passionnante biographie que leur a consacré l’historien Michel Leymarie, spécialiste de l’Action française et de Maurice Barrès, La preuve par deux (CNRS Éditions, 2014).
Débarquant de leur Limousin natal à Paris à la fin des années 1890, ils se lient d’amitié avec Charles Péguy qu’ils suivent au moment de l’affaire Dreyfus et des Cahiers de la Quinzaine. C’est Péguy qui les rebaptisera Jérôme et Jean, comme les apôtres. Adoubés par l’auteur de L’Argent, puis séduits par les thèses de Maurice Barrès, ils se placent rapidement sous le patronage de l’écrivain et figure de la droite nationaliste et antisémite, devenant secrétaires littéraires de ce dernier. C’est avec leur roman dont le personnage principal est Rudyard Kipling, Dingley, l’illustre écrivain, prix Goncourt 1906, que les frères Tharaud deviennent célèbres (mais qui se souvient aujourd’hui d’Ernest Pérochon, prix Goncourt 1920 pour Nêne ?). Journalistes globe-trotters et romanciers au style empreint de classicisme, leur petite entreprise littéraire va croître avec une régularité métronomique, jusqu’au grand prix de littérature de l’Académie française, dont ils seront lauréats en 1919, avant de confirmer leur statut d’auteurs de best seller.
Pendant près de vingt ans et sans discontinuer, avec des ventes dépassant parfois les 200 000 exemplaires, au point que leur éditeur Plon les gratifiera d’à-valoir colossaux et de pourcentages alors jamais vus dans le monde de l’édition, ils font figure d’écrivains incontournables dans les devantures des librairies. Les frères Tharaud seront définitivement consacrés par leurs pairs en devenant membres de l’Académie française. Les académiciens ne pouvant élire simultanément la fratrie, Jérôme y sera accueilli en 1938, Jean en 1946. Les deux frères décèdent à une année d’intervalle, le cadet Jean en 1952, Jérôme en 1953. Leur œuvre sombrera ensuite dans l’oubli, si ce n’est pour être étudiée par des chercheurs et historiens, ou recherchée chez les libraires d’occasion par des nostalgiques de littérature antisémite d’avant-guerre et quelques curieux de « littérature coloniale ».
Le « filon juif », une niche très rentable dans la littérature française des années 20

Jean et Jérôme Tharaud (1932, dans leur maison de Versailles)
L’expression « filon juif » est celle qu’utilise à juste titre Michel Leymarie dans un article qu’il a consacré aux frères Tharaud dans la revue Archives juives (2006), soulignant la place importante que la « vie juive » prit dans la littérature produite par la fratrie, et l’exploitation de ce « filon » éditorial très juteux dans leur œuvre, et dans celle d’autres auteurs durant la même période (alors que sont publiés en juin 1921 les Protocoles des Sages de Sion, dans le même temps paraissent des ouvrages comme Le Péril juif de Georges Batault ou le Règne d’Israël chez les Anglo-Saxons et L’Impérialisme d’Israël de Roger Lambelin, que publie Bernard Grasset ). Une œuvre française, pour parodier le nom du parti d’extrême-droite du très peu regretté Pierre Sidos. Et emplie d’ambiguïté du côté des Tharaud, entre fascination ethno-journalistique et « message indubitablement antisémite », comme le souligne l’historien.
Les Tharaud sont des globe-trotters. Ils ont côtoyé le maréchal Lyautey au Maroc durant la Grande Guerre et sont les chantres d’une France forte et éternelle, résolument colonialiste. Mais seraient aussi, selon le professeur de littérature Cheikh M. Ndiaye, qui livre dans la revue Voix Plurielles (2019) une analyse de leur roman de guerre La randonnée de Samba Diouf (Plon, 1922), des « précurseurs ou avant-gardistes du projet de décolonisation de l’Afrique occidentale française. » Dans son article « Les frères Jérôme et Jean Tharaud : avant-gardistes de la Négritude ? », l’auteur insiste sur le travail de « restauration de la mémoire et de l’imaginaire africains » accompli par les Tharaud dans ce roman. S’ils seraient donc à « l’avant-garde de la négritude », étaient-ils également le chaînon manquant entre les écrits antisémites de Barrès et ceux de Céline ?
« Je venais de poser la main sur un nid chaud, et j’en éprouvais à la fois une sensation de tiédeur et de dégoût. » Cette citation de Jérôme Tharaud datée de 1924 que produit Michel Leymarie, relative aux sentiments qu’éprouve alors le co-auteur d’une série de romans et chroniques ayant pour cadre la « vie juive » en Europe de l’Est, ne laisse aucun doute sur la fascination doublée de répulsion qu’exercent les populations juives sur la fratrie, lorsqu’elle les découvre au cours des ses périples en Hongrie et en Pologne, puis au Maroc. De leur roman Bar-Cochebas, publié en 1907 dans les Cahiers de la Quinzaine, aux thèses antisémites de Barrès auxquelles ils adhèrent, les Tharaud ne manifestent aucune ambiguïté sur leurs sentiments à l’égard des juifs, qu’ils soient français depuis des générations, habitants des Carpathes ou d’un mellah.
Durant la Grande Guerre, ils ne se privent pas de se moquer, dans des correspondances privées avec Barrès (qui, au passage, sera de ces nationalistes qui exhorteront à la lutte tout en restant soigneusement éloignés des tranchées, ainsi que le notait le philosophe Alain, de 5 ans cadet de Barrès, tout aussi antisémite, mais engagé volontaire en 1914 et qualifiant ce dernier de « lâche ») des soldats juifs de la Légion étrangère, en souhaitant que les juifs « autochtones » soient d’un niveau plus combatif, tandis que la révolution bolchévique de 1917 leur inspire ces mots : « La révolution russe est, pour une bonne part, une révolution juive. Personne ne connaît mieux que nous la question. »
Si ces propos ne choqueraient pas écrits par un historien contemporain tel que Yuri Slezkine, auteur du magistral Le Siècle juif, ils sont de la part des Tharaud l’une des multiples manifestations de leur antisémitisme « bon teint » et de leur haine du « judéo-bolchévisme » qui sera l’une des marques de fabrique de leur entreprise littéraire. Une entreprise qui séduit autant les lecteurs non-juifs que nombre d’israélites français, attirés par leurs peintures « pittoresques » de ces juifs miséreux, si éloignés des lumières du « réveil juif » en vogue au cours des années 20 dans les sphères intellectuelles juives d’alors.
Tintin au shtetl
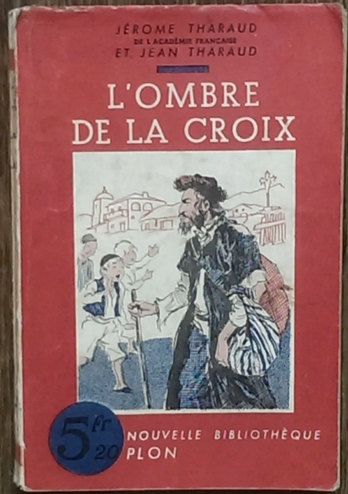
En 1912, rapporte Michel Leymarie, Jean Tharaud se rend en Hongrie et en Galicie, à Strij, puis à Bels, « forteresse de la foi juive », qu’il décrit ainsi : C’est une sorte d’Algérie, de Maroc à l’envers, où les burnous sont des cafetans noirs, où la boue noire, et épaisse d’un demi-mètre, remplace la poussière, et que couvre un ciel chargé de pluie. Une misère inimaginable encore. Une saleté pour laquelle il faut renoncer à chercher une épithète. Les deux frères se rendent par la suite à Budapest, qu’ils appellent parfois « Judapest », pour documenter ce qui sera leur premier « roman juif », L’Ombre de la Croix, publié d’abord en feuilleton en avril 1914 dans L’Opinion, puis chez Plon en 1919. Le succès en librairie est immédiat, les ventes totaliseront 216 800 exemplaires.
Dans L’Ombre de la Croix, un cabaretier juif d’un village des Carpathes va en Pologne commander une Torah copiée de la main du Tzadik de Bels, un des quatre rabbins miraculeux de l’Europe orientale. Son séjour est prétexte à de longues descriptions de « baroques personnages d’un autre âge et d’un autre climat », descriptions qui virent rapidement aux stéréotypes antisémites : Les mains, les longues mains nerveuses, s’agitaient avec une rapidité folle, en mille gestes qui exprimaient à merveille toutes les nuances des pensées qui traversaient les esprits. Chacun de ces longs doigts minces, terminés par des ongles noirs, se démenait devant les visages comme autant de marionnettes, autant de petits personnages doués d’une vie particulière ; et si par hasard les mains s’arrêtaient un instant d’expliquer et de convaincre, elles se plongeaient fiévreusement dans les barbes, pour aller y chercher un pou ou une idée, tandis qu’une soirée de shabbat où est présentée la carpe farcie traditionnelle devient ainsi un repas où les fidèles se baffrent, l’humour des banquets d’Astérix écrits par Goscinny en moins : Les mains aux ongles noirs fouillaient dans le poisson, déchiquetaient les carpes, se plongeaient dans la sauce qui coulait sur les caftans et les barbes. […] Maintenant, c’étaient les nouilles qui pendaient à tous les doigts, glissaient le long des barbes, sur la lustrine ou la soie des caftans.
La deuxième partie du roman a pour protagoniste un jeune garçon, Ruben, qui se fait couper les papillotes par des chrétiens alors qu’il regardait, fasciné, la cérémonie de Noël. En s’échappant, il tombe malade pour avoir regardé une croix à un carrefour. Le symbole est transparent : bien que juif et élevé selon les plus strictes prescriptions de sa religion, le garçon est attiré par le catholicisme. Après qu’il eut recouvré la santé, son grand-père, un vieux copiste, est à son tour malade et Ruben offre sa vie pour prolonger cette vie en déposant dans l’Aron Hakodesh, L’Arche sainte aux Torah, un parchemin qui consigne sa décision. On eût été étonné de ne pas trouver évoquée dans l’œuvre l’histoire du sacrifice rituel des enfants auquel se livreraient les Juifs au temps de la Pâque ; elle ne manque pas d’être présentée, mais ici le narrateur s’efface derrière les chrétiens du village qui rapportent l’histoire, comme le note Michel Leymarie.
Le ton est quasiment identique dans les parutions suivantes des Tharaud, exploitant ce « filon juif » sous toutes les coutures. Et si les critiques s’accordent, à la lecture des premiers « romans juifs » des Tharaud, à louer l’indéniable talent de conteurs des auteurs, leurs peintures de ces populations reste dénuée de toute empathie. Le sthetl et ses habitants, pour les frères Tharaud, c’est Rendez-vous en terre inconnue revu et corrigé façon “Bienvenue chez les youpins !”.
Les Tharaud “historiens” : Zemmour des années folles
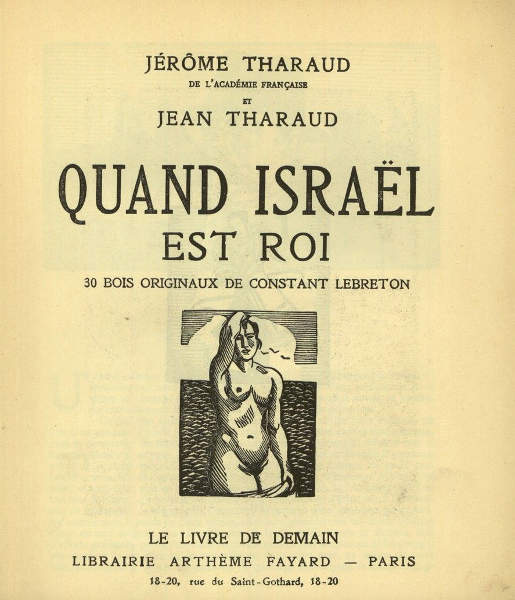
Avec Quand Israël est Roi, les Tharaud se veulent davantage historiens, mais leur vision de la révolution et de la contre-révolution en Hongrie décrite ici est digne des inepties proférées par Éric Zemmour dans ses ouvrages à prétention historique. Écrit en 1920 à la suite d’un nouveau voyage en Hongrie, le livre est grassement payé par la Revue des Deux Mondes, où il paraît d’abord en feuilleton sous le titre de Bolchevistes de Hongrie ; dédié à Maurice Barrès, il est publié chez Plon en juin 1921. Là encore, le succès est fulgurant. Deux traductions anglaises sont proposées, puis une américaine et une roumaine. Le tirage de Quand Israël est roi, toutes éditions confondues, s’élèvera à 101 000 exemplaires.
Le livre compte trois parties, centrées autour des figures du comte Tisza, de Karolyi et de Bela Kun. De Karolyi, président de la République provisoire de Hongrie d’octobre 1918 à mars 1919, les auteurs font une sorte de Kérensky hongrois manipulé par des conseillers juifs qui installent, jusqu’en août 1919, un pouvoir bolchevique, « une Jérusalem nouvelle » « sortie du cerveau juif de Karl Marx et bâtie par des mains juives sur de très anciennes pensées ». Pour « masquer le caractère sémitique de ce mouvement communiste » – sur vingt-six commissaires du peuple, dix-huit sont juifs –, un chrétien est placé à la tête du mouvement par Bela Kun, dont le portrait est édifiant : La tête ronde, complètement rasée, de vastes oreilles pointues, les yeux gros et saillants, le nez court, les lèvres énormes, une bouche largement fendue, pas de menton, l’air d’un lézard, tel apparaît Bela Kun. Au moral, un petit employé juif, débrouillard et rusé, comme on en voit des milliers à Budapest.
Comme les Tharaud n’ont pu se rendre en Russie « pour étudier sur place l’activité d’Israël dans cette grande aventure », ils expliquent qu’ils s’en sont fait « une idée par une autre révolution, calquée sur le modèle de la révolution russe. » Les auteurs prétendent ainsi expliquer le rôle révolutionnaire de certains Juifs, « sortis pour la plupart de quelque ghetto campagnard », par leurs croyances religieuses passées. Autrement dit, les ghettos seraient des nids de révolutionnaires et le mouvement bolchevique, réduit à une cause unique, s’expliquerait par le rôle des Juifs. C’est sans compter que ni Marx ni Lassalle ne sont sortis d’un ghetto polonais… Les Tharaud affirment que le mouvement bolchevique à Budapest – comme à Moscou – est un assaut de « l’Orient chassé, il y a deux siècles, de la forteresse de Bude » et constitue une nouvelle attaque des barbares asiatiques contre la civilisation. Vous avez dit Zemmour ?
Dans Quand Israël est roi, œuvre au titre-programme, les Tharaud se font les adeptes d’une théorie du complot juif qui les inscrit dans une droite extrême. Léon Daudet ne s’y trompe pas qui, marquant la filiation des auteurs, écrit que leur livre, « exposé d’un grand et fier courage », est « un enseignement » et « démontre cette vérité, signalée par Drumont, creusée par lui – avec cette vision dantesque qui lui appartenait : LA RÉVOLUTION, C’EST LA GUERRE JUIVE. […] La révolution, ou guerre juive, est une guerre d’extermination et d’expropriation. Elle veut l’argent, la peau, le sol. »
Au début de leur ouvrage, les Tharaud déplorent l’oubli dans lequel est tombé l’effort qu’a soutenu pendant des siècles « pour la Chrétienté tout entière » la vieille citadelle d’Occident de Bude. Les dernières lignes donnent la parole à « la voix du Chrétien » qui, après l’assaut des Turcs, voit dans le mouvement dirigé par Bela Kun « le dernier assaut de l’Asie », et, en quelque sorte, un choc de civilisations, la menace tangible de la corruption d’une identité nationale et occidentale par des éléments étrangers. Sans s’interroger sur l’existence ou non de croyances religieuses chez les révolutionnaires russes ou hongrois, les Tharaud invoquent un lien entre judaïsme et bolchevisme. Selon eux, Karl Marx et Bela Kun, « las de chercher au ciel ce royaume de Dieu qui n’arrive jamais, […] l’ont fait descendre sur terre ». La version définitive de Quand Israël est Roi dit d’une façon caricaturale : « Le Capital de Karl Marx, c’est du Talmud encore ! » Vous avez dit grand remplacement ?
L’An prochain à Jérusalem !, best seller 1924

Les Tharaud publient en 1924 L’An prochain à Jérusalem !, d’abord en feuilleton dans la Revue des Deux Mondes puis chez Plon la même année. Dès septembre 1924, c’est « le livre, selon leur éditeur, qu’on continue à vendre le plus à l’heure actuelle sur Paris ». Toutes éditions confondues, il est publié à plus de 106 000 exemplaires.
Nos Tintin et Milou se sont par la suite rendus en Palestine, avec les recommandations de l’écrivain, poète et militant sioniste André Spire. Il s’agit ici d’un travail de journalistes, une suite de portraits de personnalités, de Théodore Herzl au baron Edmond de Rothschild, en passant par Ben Yehouda, artisan de la renaissance de l’hébreu, d’interviews et de reportages in situ. Pour eux, le projet de Herzl en Palestine est justifié par le fait que « les Juifs étaient au milieu des autres peuples une sorte de corps étranger qui troublait les vies nationales » et qu’eux-mêmes « s’y trouvaient mal à l’aise. », tout en doutant des capacités d’adaptation des pionniers qu’ils rencontrent, notant que « c’est une idée folle, de vouloir rassembler dans ce pauvre pays toute la juiverie de l’univers. »
Ici encore, les frères Tharaud recherchent le « divertissement », trouvant une fois encore à Jérusalem une source d’exotisme juif. Source qui ne se tarira pas, l’obses-sion des auteurs les conduisant ensuite en Afrique du Nord. Ainsi dans Rabat, ou les heures marocaines, le(s) narrateur(s) se trouve(nt) « tout à coup dans un autre univers, à mille lieues d’ici, en pleine Galicie, au pays des caftans noirs » : au Maroc, ils retrouvent des « juifs vêtus de souquenilles », « sous une autre lumière, toujours pareils sous tous les cieux ». Dans Marrakech, ou les Seigneurs de l’Atlas, un chapitre entier est consacré – sous le titre « un ghetto marocain » – au mellah, « un des lieux les plus affreux du monde ».
La Petite Histoire des Juifs, version Tharaud
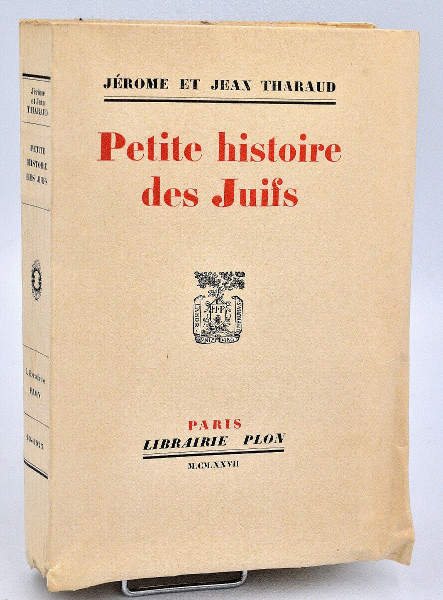
La Petite Histoire des Juifs paraît d’abord dans la maurrasienne Revue Universelle avant d’être publiée chez Plon en 1927. L’ouvrage se veut historique et l’œuvre de « spécialistes » du « fait juif ». On y trouve pêle-mêle des portraits de Moïse, de Maïmonide et de… Chaplin ! Ici encore, préjugés et clichés antisémites côtoient prétentions d’historiens. Ils poursuivront dans la même veine avec avec Quand Israël n’est plus roi, où ils reprennent le thème selon lequel les Juifs, pourtant persécutés, menaceraient les sociétés occidentales.
Le succès de leurs ouvrages ne se démentira pas jusqu’à la fin des années 30, qui verra nos infatigables globe-trotters parcourir l’Indochine, la Syrie, l’Espagne et l’Éthiopie en guerre… Le « filon juif » s’épuisera, avant de connaître une nouvelle forme, encore plus virulente et destructrice, dont Céline sera l’épitomé. Dans leur autobiographie publiée après la Deuxième Guerre mondiale, ils affirment avoir, des Carpathes à Jérusalem, bénéficié d’informations fournies par des amis juifs ou par d’autres rencontrés sur place, et n’avoir pas à choisir entre philosémitisme ou antisémitisme, ces termes n’ayant pour eux aucun sens, se plaçant juste en terme « d’observateurs »… Des observateurs en voyage en Allemagne en 1933, qui ne manqueront pas de minimiser l’antisémitisme en action, de même que les mesures antijuives prises en Italie en 1938, alors qu’ils y effectuent un reportage.
Leur attitude durant l’Occupation sera toute aussi empreinte de ces sentiments de fascination-répulsion, entre leur admiration d’anciens combattants et de nationalistes affichée pour Pétain, le refus de voir leurs écrits antisémites utilisés par les médias collaborateurs, et leur souhait de victoire des Alliés.
Que faut-il alors retenir de l’œuvre des frères Tharaud ? En 1923, l’auteur de Belle du Seigneur, Albert Cohen, les compte parmi les romanciers français les plus notoires à avoir « découvert les Juifs » : Ils sont les peintres officiels des fantoches à papillotes, en caftans verdis et couverts de taches que cachent les barbes vierges saupoudrées de tabac râpé. Enquêteurs excellents, ils vont sur place chercher leur documentation ; à leur retour, ils montrent les marionnettes frénétiques des synagogues et les crânes féminins que les perruques de satin recouvrent chastement., tandis que François Mauriac écrivait à propos de la fratrie Tharaud « un violent instinct raciste se délivrait ici par le pittoresque ».
Leur antisémitisme obsessionnel, qui constitue une tache indélébile sur leur carrière d’écrivains et de journalistes, a été soigneusement rayé de la carte par l’Académie nationale, qui sur son site Internet se garde bien de mettre en lumière les ouvrages les plus populaires des frères Tharaud, ce « filon juif » et surtout antisémite qui fit leur richesse et contribua à leur notoriété.
Dans la biographie qu’il leur consacre, Michel Leymarie constate qu’ils furent le « baromètre » d’un lectorat, certes non homogène, et le reflet d’une partie des passions de la société française d’il y a près d’un siècle. Toute ressemblance avec…
Alain Granat
Sources : Les frères Tharaud, de l’ambiguïté du « filon juif » dans la littérature des années vingt, de Michel Leymarie (Archives juives, 2006)
Commander la biographie des Frères Tharaud La preuve par deux, de Michel Leymarie (CNRS Éditions, 2014) sur le site leslibraires.fr
© photos : DR
Article publié le 10 septembre 2020. Tous droits de reproduction et de représentation réservés © 2020 Jewpop

Lettres ouverte à JEWPOP
Messieurs de JEWPOP
Vous avez -dans une rubrique qualifiée pompeusement culture – cru humoristique de mettre Les Frères THARAUD – écrivains ayant manifesté un antisémitisme pathologique – et Éric ZEMMOUR sur un pied d’égalité
C’est désolant de la part d’un site se voulant juif
Il y avait tellement d’autres personnalités à citer BHL, les Einthoven, et même l’inneffable Schneiderman.
Vous avez choisi celui qui dérange , celui criant tous les jours “ Le Roi est nu “
Dommage. Pour vous
Max Sitbon
Bonjour
Ma réaction à la comparaison ZEMMOUR Frères Tharaud
Bonjour
je sis extremement etonné de votre paralléle de ces antisémites, avec l’oeuvre et le personnage de Zemmour, qui a le courage de dire la verité et d’en subir les consequences en vivant dans la menace.