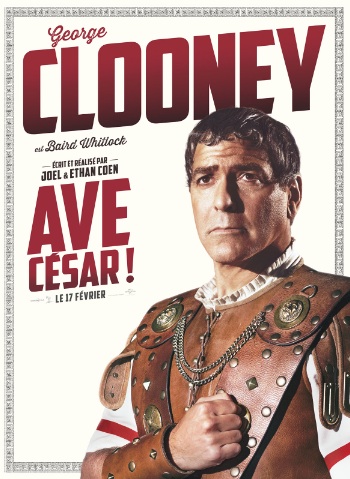En 1899, paraissait un ouvrage qui fera date dans l’histoire de la pensée du social : Théorie de la Classe de loisir. Son auteur, Thorstein Veblen, sociologue d’origine norvégienne, y décryptait les mœurs du monde affairiste et la comédie humaine de la bourgeoisie non industrieuse yankee. Il pointait les manières barbares, les instincts prédateurs, d’une leisure class qui utilisait l’argent comme marque de la réussite. Une « classe de loisir » pour laquelle « loisir » ne signifiait ni paresse, ni repos, mais mise en oeuvre de moyens d’afficher – comme un exploit – la richesse possédée, la domination assurée. Un milieu qui ne cessait de s’inventer des besoins inutiles, pour marquer et maintenir continument, de façon éclatante, à travers ceux là, sa supériorité sur toutes les autres populations. Il lui était intrinsèque de les humilier par sa supériorité, ses exploits, sa fortune, exhibés.
Une classe de parvenus WASP, non pas animée par la possession simplement d’une richesse légitimement acquise par ses compétences et sa créativité ; mais ordonnée par l’impératif de sa mise en évidence, de son affichage, dans une consommation ostentatoire (conspicious consumption). Il s’agissait toujours de s’avantager. Le génie de Veblen fut de mettre ce gaspillage, cette ostentation, le tropisme corrélé vers des sports – tels que la chasse -, propices aux rodomontades et crâneries et au « cabotinage de clairière », au compte d’une réversion spirituelle. En relation avec les « hautes périodes de la Civilisation barbare ».
Cette persistance « barbare » de la prouesse belliqueuse, apparentait, disait Veblen, l’homme de loisir à la mentalité délinquante de « bas étage ». S’entretenaient, dans la Classe de loisir, dans son décorum même, sous ses apparences policées, une tendance prédatrice, une inclination à verser dans l’agressivité criminelle.
*

1971. Un petit lieutenant de police, un inspecteur de la « criminelle », fait son apparition sur les écrans de télévision des networks nord américains. Il a pour nom Columbo, et les producteurs, scénaristes, réalisateurs, ainsi que l’acteur principal qui lui donnera ses traits éponymes, le jettent, par ses fonctions d’enquêteur, en plein cœur du milieu californien de la « Classe de loisir ». À la butée du Pacifique. Entre Hollywood et Malibu. Dans les appartements et villas luxueuses, ou bureaux de haut standing de Los Angeles. Aux murs : des étalages de tableaux – chromos modernistes – qui les tapissent d’argent. Entre les murs, tout y est imposant : les salles de bain y sont immenses, les lits king size, les canapés profonds, les moquettes épaisses, et les baies des fenêtres grandioses. À l’extérieur : les piscines larges, les voitures impressionnantes, les palmiers hauts. Les hommes y portent costumes, nœuds papillons, boutons de manchettes, ou peignoirs de la meilleure coupe. Les femmes, des robes provenant des meilleurs couturiers, des broches resplendissantes, et des sacs à main du plus beau cuir. Toujours, ils viennent de tuer sans remords. Dans le cocktail des passions morbides qui les mènent : avidité, envie, arrogance, vanité, toute puissance, ressentiment, jalousie, possessivité, fatuité, convoitise… Et sûrs d’eux, ils ont, sous nos yeux, maquillé leur crime, fabriqué de faux indices, vaporisé un brouillard de leurres.
Dans ce monde inconnu, qu’il découvre lors de chaque épisode, le lieutenant du LAPD passe pour un émigrant à peine débarqué. Il a l’allure d’un Tramp ou d’un Hobo : par-dessus couleur mastic fripé, veste mal boutonnée, cigares à demi fumés, pleinement mâchonnés, qui répandent leur cendre partout, tignasse mal coiffée. Il se nourrit quelques fois de sandwichs, plus souvent d’œufs durs et de café. Il parle un anglais aux intonations un brin intimidées sinon serviles : M’dame. Il a des gestes un peu « plouc », se gratte la tête lorsqu’il est dubitatif, et se frappe le front lorsqu’une idée lui vient. Il possède un carnet ordinaire « aide mémoire », et souvent doit partir à la recherche de son crayon au fond des ses poches. Summum de sa ringardise, il conduit une voiture européenne, vieux cabriolet 403 décapotable, grisâtre et cabossée. Il ne maitrise aucun des Codes de bienséance de la Upper Class. Il a, encore, l’air un peu potz par ses émerveillements naïfs, un peu shlemiel par ses maladresses à répétition, un peu jlob par sa façon de s’incruster sans être invité, un peu shnorrer à l’occasion ; et pour l’ « élite » hautaine et condescendante de la « Classe de loisir, c’est un vrai schloupen, un rabat- joie, par la façon qu’il a de les insécuriser avec ses questions ridicules. Et s’il n’a pas de yiddishe mama qu’on lui connaisse, il a une femme « hors champ » qui pourrait bien être une yah’né. Bref c’est un type que la Classe de loisir regarde de haut, qu’on doit pouvoir rouler facilement à coup d’arguments faciles, qu’on peut mener par le bout du nez au moyen de flatteries sans frais. Pensez ! En plus, il est sujet au vertige, a le mal de mer, ne sait pas nager, et ne supporte pas les autopsies…
Grave erreur ! Sous ses traits modestes et ses airs empotés, il décortique le texte des indices, écrit par les assassins. Il décrypte les signes d’incohérence. Note les incongruités. Toujours à partir d’un premier accroc découvert ou soupçonné dans les fables fabriquées pour égarer les policiers. Au fur et à mesure de ses interrogations ou doutes, il vient les livrer aux criminels, sollicite leur avis éclairant, caresse leur suffisance, et ce faisant défait leur garde. Dans la tranquillité rassérénée de leur mépris, de leur prétention, de leur vanité, ils finissent acculés à la vérité de leur crime. Le lieutenant Columbo, c’est un h’ouh’em.
Sous son grimage « italien », utilisé de nombreuses fois par les scénaristes et acteurs juifs américains dans l’entertainment (cf. Les Chico, Groucho, Harpo, Zeppo, des Marx Brothers, ou le personnage de Constanza dans Seinfeld), c’est un « caractère » d’émigrant juif emblématique que vient synthétiser en Idéal-type, le personnage de Columbo.
Il incarne une figure possible, populaire, de cet émigré qui découvre l’Amérique réelle, et non plus rêvée. Il est ce « paria conscient » qu’évoquait Hannah Arendt dans son article « Nous autres réfugiés » (in La Tradition cachée), avec son humanité, son humour, son intelligence désintéressée et sa sagacité. Bardé ainsi, il dynamite les idoles de la fatuité sociale, de l’arrogance possédante, de l’hypocrisie argentée, des parvenus sociaux qui pensent cacher derrière leur étalage d’agent, la misère de leur soi-disante exemplarité morale.
Ils avaient noms Richard Levinson, William Link (producteurs), Peter Falk (acteur) ; Steven Bochco fut le scénariste du premier épisode, et Steven Spielberg en fut le premier réalisateur. Ils parfumèrent d’une Jewish Touch, qui portait en elle encore un peu de la fragance d’une Jewish Soul, le lieutenant Columbo ; à la découverte d’une « Amérique » de clinquants et d’illusions. C’est « sa femme qui devait être contente… » !
Gérard Rabinovitch
Article paru dans l’Arche (nouvelle formule trimestrielle), extrait de son dossier d’été sur les Juifs en Amérique, et publié avec l’aimable autorisation de son auteur.
Copyright photos : DR
Peter Falk et son épouse Shera